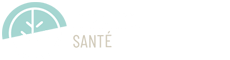Les changements majeurs du contexte médical impliquent une nouvelle définition de la santé et des moyens de la maintenir ou de l’enrichir
« Bonjour, comment allez-vous ? » est la question que l'on pose le plus souvent à ceux que nous rencontrons au cours d'une journée. Selon l'intention associée à la question, celle-ci peut être un simple rituel pour faciliter la prise de contact, ou une réelle marque d'intérêt pour la santé de son interlocuteur. « Ça va, mais j'ai des soucis professionnels...» La réponse est double avec d'une part un « oui ça va » qui concerne probablement un aspect de la personne, et d’autre part un "oui mais" qui se rapporte à d'autres aspects de la vie de la personne. La santé semble donc concerner bien plus que la santé de nos organes et l'absence de maladies. Si la santé concerne de multiples aspects de la vie, y a-t-il un élément qui puisse rassembler les diverses composantes en un tout cohérent ? Intervenir pour modifier un état de santé nécessite de préciser ce que signifie ce mot fort chargé de signification. Nous avons tendance à oublier que la santé est un bien précieux qui conditionne la réalisation de tout ce qui compte pour nous dans une vie. Le rituel de prise de contact est certainement là pour nous le rappeler.
Un changement de paradigme de la notion de santé
Le mot santé est une abstraction, comme pour quelque chose que l'on possède ou pas. Quelque chose de matériel, comme l'argent, une voiture, ou quelque chose d'immatériel comme un état de bien-être, de sécurité, d'amour...etc. On dit bien "avoir la santé" Mais contrairement à des mots comme changement, communication, spiritualité, soins, guérison... qui peuvent facilement se transformer en un verbe, c'est-à-dire en un processus d'action (changer, communiquer, spiritualiser, soigner, guérir…), le mot santé ne peut être transformé en verbe. Ceci est lourd de conséquences, car nous finissons par croire que la santé est quelque chose qui est donné à certains, sur lequel nous n'avons pas beaucoup de pouvoir. Quelque chose qui nous serait accordé ou pas par la chance ou la grâce de Dieu.
Une définition statique de la santé selon l'OMS
La santé en tant qu'état est au coeur de la définition de l’OMS de 1948 : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». Quel est l'inconvénient à percevoir la santé en tant qu'état ?
1- le caractère absolu du mot "complet" par rapport au bien-être. Le mot complet laisse supposer une exigence idéalisée de la santé. Cet adjectif "complet" laisse la plupart d'entre nous dans un état de santé toujours incomplet et insatisfaisant. La perception de l'incomplétude de la grande majorité des individus a certainement contribué à l’hyper médicalisation de la société. Il convient de répondre aux constantes insatisfactions des consommateurs en quête de solutions du marché pour complèter leurs santé. Car il y a toujours quelque chose de plus à consommer, avec l'aide des médicaments, des vitamines, du dernier régime à ma mode, de la médecine esthétique, du sport, du yoga ou du Pilate, le bronzage, et surtout les solutions antivieillissement...etc. On attend du corps un complet état de fonctionnement en toutes circonstances, au même titre que son frigo, sa voiture ou sa télé.
2- la soumission à des normes sociales. Qui évalue le complet état de bien-être physique, mental et social des individus ? Les organisations médicales se chargent de définir les standards physiques et biologiques auxquels votre corps doit obéir pour tendre vers l'état promis de complet bien-être, les industries du médicaments proposeront de corriger les écarts ou déviations des normes dites "consensuelles" dans lesquels vous devez rentrer pour prévenir l'apparition des graves menaces qui pèsent sur vous, les industries de la cosmétologie et du bien-être vous promettent des solutions à des situations "dysfonctionnelles" auxquelles vous n'aviez jamais pensé auparavant (la calvitie, la jeunesse retrouvée de votre peau ou de votre érection...) Nous décidons d'être des consommateurs de santé et de bien-être, mais avant tout pour se soumettre aux exigences des normes sociales qui définissent les caractéristiques de l'humain moderne idéal, au risque de négliger ou d'y perdre définitivement nos propres critères de santé, voire notre âme. La santé est une notion d'une extrême subjectivité, car on peut se sentir en mauvaise santé, malgré l'avis contraire des professionnels de santé, et nous pouvons nous sentir en bonne santé malgré un âge avancé, la présence d'un handicap ou d'une maladie chronique.
2- l’absence de prise en compte du contexte. En 1948, on mourrait surtout de maladies aiguës et les maladies chroniques entraînaient des décès prématurés. A la fin de l’horreur de la deuxième guerre mondiale, la vision idéalisée d'un complet état de bien-être pour tous, était bien compréhensible. Pourtant le contexte de la santé a profondément changé en un demi-siècle. Les progrès médicaux et les mesures d'hygiène et de santé publique nous ont offert un important gain de longévité, mais avec pour contrepartie l'explosion des maladies chroniques et environnementales. Celles-ci représentent maintenant la majeure partie des dépenses de santé, ce qui exerce une pression sur la viabilité des organismes d’assurances publiques ou privées en matière de santé. La définition de l'OMS est devenue incomplète ou parfois contre-productive, car elle condamne les personnes atteintes de maladies chroniques et de handicaps à ne plus pouvoir accéder à la santé. Cette définition minimise le rôle de la capacité humaine à faire face de manière autonome aux défis physiques, émotionnels et sociaux en constante évolution de la vie, et à fonctionner avec un sentiment de bien-être.
3-L'inopérationalité du terme "complet " Comment mesurer de façon objective ce qui caractérise la santé, à savoir son aspect "complet" ? Le terme "complet" présuppose l'existence de diverses composantes physiques, mentales et sociales à prendre en compte dans l’évaluation des professionnels de santé. La médecine moderne se revendique scientifique car elle définit avec beaucoup de précision l'objet de son évaluation à la suite d'une intervention médicamenteuse ou autre. En raison de sa référence à un "état de complet bien-être", la définition de la santé reste bien souvent impraticable.
Il s’avérait donc nécessaire de redéfinir la notion de santé, pour l’adapter aux changements sociaux et médicaux et la rendre plus opérationnelle (mesurable) au regard des soignants comme des soignés. Par exemple en contextualisant la notion de santé, c'est-à-dire en précisant des situations dans lesquelles un sujet a besoin de sa santé : "une santé pour quelle finalité ?" et en définissant les responsabilité des parties prenantes intervenant dans un processus de santé.
Une définition dynamique et systémique de la santé
Il faut attendre 2011 pour que H. Hubber et coll., proposent à l’OMS dans l'article "How should we define health? " publié dans British Medical Journal, une nouvelle définition de la santé « La santé est la capacité à s’adapter et à se prendre en charge face à des problèmes physiques, émotionnels et sociaux ». Si cette nouvelle définition peut paraître banale, elle présente pourtant quelques aspects révolutionnaires" par rapport à celle de 1948. Car la santé n'est plus un état mais des processus, et en particulier ceux de l'adaptation et de la prise en charge individuelle.
1-La notion de capacité à s’adapter. La santé n'est plus un état qu'on possède ou qu'on ne possède pas, mais un processus constant d'adaptation aux changements du monde dans lequel nous vivons, afin de permettre à une personne de poursuivre ses buts de vie. La notion de processus d’adaptation présuppose la possibilité de progressions possibles, des changements à attendre, des capacités de résilience pour faire face aux situations d'adversité, l'existence de ressources à activer, et la préservation de composantes essentielles chez chaque individu.
2-La notion de prise en charge fait intervenir la responsabilité d’une personne à mettre en œuvre le processus dynamique qui conditionne la préservation ou le développement de la santé. La santé ne dépend plus uniquement de ressources externes, par exemple les compétences des professionnels de santé, mais aussi des ressources interne du sujet qui a pris la décision de participer activement à l'amélioration de sa santé. En activant une « technologie interne » qui complète et soutient la « technologie externe » de la médecine moderne, le sujet devient un acteur de sa santé.
3- Une vision globale et systémiques de la santé. La santé fait donc intervenir de nombreuses composantes physiques, émotionnelles et sociales. Lorsque ces diverses composantes interagissent pour contribuer à la réussite du projet individuel, la santé peut être au rendez-vous. Ce qui est mesurable est le niveau de bien-être d’un individu, ce niveau reflétant l'adéquation de ses capacités d'adaptation et d’auto-efficacité par rapport à la réalisation de ses buts dans un contexte donné.
Un sujet s’adapte physiquement à des conditions changeantes, en adoptant de nouveaux comportements, en mettant en place des réponses comportementales protectrices, en réduisant le potentiel de dommages de certaines habitudes, et en rétablissant un équilibre ou une homéostasie biologique. L'apparition des symptômes traduit une incapacité de l'organisme à faire évoluer son homéostasie, et parfois à la transformer lorsque les changements de l'environnement sont majeurs.
Un sujet s’adapte mentalement et émotionnellement en développant un "sentiment de cohérence" qui comporte les capacités à comprendre une situation difficile et à y amener des réponses pertinentes. Le sentiment de cohérence permet de se remettre d'un stress psychologique intense et à prévenir les troubles de stress post-traumatique. Il est aussi l’élément moteur d’une démarche de promotion de la santé.
Un sujet s’adapte socialement par ses capacités à remplir ses obligations, à gérer sa vie avec un certain degré d'indépendance malgré ses conditions médicales, à participer à des activités sociales, à poursuivre un travail, et à se sentir en santé malgré la présence de limitations. La recherche montre que ceux qui ont appris à mieux gérer leur vie malgré la présence de maladies chroniques signalent une amélioration de leur état de santé et de leur niveau d’énergie, une réduction de leur stress et de leur état de fatigue, de leur handicap et de leurs limitations dans leurs activités sociales. Quand les personnes sont capables d'élaborer des stratégies d'adaptation efficaces, les dysfonctionnements liés à l'âge modifient peu la qualité de vie perçue, un phénomène connu sous le nom de paradoxe du handicap.
Une vision enrichie de la santé
La formulation de la santé en tant que « capacité à s'adapter et à s'autogérer » complète et enrichit la notion précédente de la santé. Elle accorde plus d’importance à l'autonomisation du patient (par exemple, en modifiant un mode de vie) qu’à la simple suppression des symptômes par une intervention médicale, et fait apparaitre le besoin de nouvelles compétences actuellement absentes chez la plupart des professionnels de santé.
L’évaluation de la capacité d’un sujet à « s'adapter et à s'autogérer »
Cette formulation apporte la possibilité de mesurer et d'évaluer plus facilement les effets physiques, cognitif et sociaux des interventions selon deux échelles distinctes. D’une part des mesures objectives, biologique et physiologique du niveau de santé, et d’autre part des mesures subjectives du niveau de bien-être d'une personne dans sa vie personnelle, sociale et professionnelle. Le processus d’amélioration de la santé est perceptuel et holistique car il fait intervenir des variables objectives (âge, sexe, activité, état physique et biologique…etc.), subjectives (croyances, valeurs, émotions, spiritualité…etc.), culturelles (ce que votre communauté croit de la santé et de la maladie) et sociales (vos interactions avec les autres, le lieu de vie, le travail, l’environnement, la nature…) Le niveau de bien-être apparaît être le seul paramètre permettant l’évaluation du bon fonctionnement des multiples variables citées.
La forte implication et responsabilité du patient
La « capacité à s'adapter et à s'autogérer » d’une personne pour répondre aux changements du contexte, implique une clarification des buts recherchés, des modifications des relations entre les différentes variables qui la constitue, un système de feedback ou d’intéroception permettant de réaliser les ajustements qui s’imposent. Cette approche perceptuelle (extéroception, proprioception et intéroception) et non analytique bouleverse l’expérience des patients de la santé, de la maladie et de la guérison, ainsi que l’expérience des soignants. Cette approche donne du pouvoir au patient, et en fait émerger le besoin de nouvelles compétences chez les soignants.
De nouvelles compétences et de nouveaux métiers
De nos jours, quels sont les professionnels de santé compétents dans l’accompagnement des patients à « s'adapter et à s'autogérer » ? Bien peu, car ils n’ont pas été formés à une approche qui ne relève pas du soin, mais de la science de l’accompagnement des changements comportementaux. Il existe un immense fossé entre les recommandations médicales visant l’adaptation du patient aux changements d’habitudes de vie requis par sa condition médicale, et la capacité de ces patients à les mettre en œuvre. Pour combler ce fossé, les compétences du coach sont plus utiles que celles du clinicien. Pour répondre à ce besoin nouveau, il est fort prévisible que de nouveaux métiers émergeront. C’est certainement la raison du développement mondial important du métier de coach de santé.
|
Sources |
OMS 1948 |
H. Hubber et coll. 2011 |
|
Définition de la santé |
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ». |
« La santé est la capacité à s’adapter et à se prendre en charge face à des problèmes physiques, émotionnels et sociaux. » |
|
Présupposés |
La santé en tant qu’état idéalisé |
La santé comme processus dynamique |
|
Buts de la santé |
Atteinte et maintient du complet bien-être des patients |
Adaptation des individus aux changements de contexte de vie |
|
Conséquences |
Médicalisation de la société |
Empowerment des patients |
|
Ressources |
Externes, avec une expertise médicale de la pathogénèse pour traiter et prévenir les maladies |
Internes et externe, avec une expertise de la salutogénèse et du changement humain pour promouvoir la santé |
|
Évaluations |
Non-opérationnelles pour mesurer ce qui est complet dans un état de bien-être |
Opérationnelles pour mesurer les progrès d’une personne par rapport à un objectif et un contexte de réalisation |
Différences et complémentarités entre deux visions de la santé
Ces deux définitions de la santé ne s’opposent aucunement, mais se complètent naturellement. Les situations médicales aigues bénéficieront au mieux de l’expertise médicale moderne qui chaque jour sauve des vies par la performance de sa technicité. Dans ces situations d’urgence, la participation du patient est réduite voire inexistante. Il s’agit de sauver une vie, et de rétablir au mieux un état optimum de fonctionnement. Dans les situations médicales chroniques, la santé dans sa définition actuelle, est performante pour stabiliser un symptôme (diabète, lipides sanguins, chiffres tensionnels, réaction inflammatoire…) et prévenir son aggravation, mais bien démunie pour aider les patients à modifier durablement leurs habitudes de vie, en agissant sur les moteurs du changements humains. La présence du symptôme témoigne de l’incapacité du sujet à « s’adapter et se prendre en charge » face aux changements de son environnement. Le symptôme a vocation à s’effacer ou disparaître quand le sujet à pu rétablir un équilibre de vie compatible avec les buts recherchés.
Les conditions de réussite d'un accompagnement au changement
Les résultats d’une démarche d’adaptation et de prise en charge de soi ne peuvent jamais être garantis. Dans une approche biomédicale de cause effet, telle que la prescription d’un médicament, le résultat est prévisible, avec quelques marges d’erreurs. Dans une approche systémique telle que celle de l’accompagnement au changement, une même causalité peut produire divers effets ce qui signifie que le résultat du processus d’adaptation et de prise en charge de soi reste imprévisible. On peut aboutir une stabilité ou une amélioration des symptômes, ou une meilleure qualité de vie, une rémission longue ou parfois définitive. On peut cependant définir les conditions les plus favorables à la réussite d’une démarche de changement qui fait intervenir d’une part un sujet/patient, son soignant/accompagnateur, et la relation entre ces deux personnes. La première condition est le degré d’ouverture du patient vis-à-vis des processus de transformations qui peuvent impacter son niveau de santé. La seconde condition concerne les compétences du coach dans l’utilisation des outils et modèles de changements et dans ses capacités à créer un climat de confiance et de sécurité. La troisième condition concerne la dynamique d’interaction entre le coach, le patient et l’objet de l’accompagnement.
1-L’implication du sujet dans le processus de changement. Le sujet a-t-il conscience qu’il a contribué, par ses habitudes de vie, à l’apparition de son problème de santé, et qu’il a aussi le pouvoir d’influencer l’évolution de sa maladie ? Est-il prêt à remettre en cause une ou plusieurs habitudes de vie ? Est-il prêt à explorer ses motivations au changement, à faire preuve de flexibilité et de responsabilité face à ses problèmes de santé ? S’autorise-t-il à s’imaginer en bonne santé ? Accepte-t-il l’incertitude ? Peut-il concevoir la maladie comme la fin d’une expérience de vie et le début de quelque chose de nouveau à créer ? Est-il prêt à faire preuve de volonté et discipline dans la mise en place de nouvelles habitudes de vie ?
2-Les compétences de l’accompagnateur. La mise en place durable de nouvelles habitudes de vie personnelles (alimentaires, physiques, relationnelles, sociales, professionnelles, gestion du stress…) nécessite souvent des changements de niveau II, c’est-à-dire au niveau des règles inconscientes qui autorisent et motivent l’adoption des nouveaux comportements. Qu’elle est la compétence du coach à aider son client à définir une « identité incarnée » susceptible de déclencher une motivation au changement. Une « cognition incarnée » signifie que la formulation de ce que l’on voudrait atteindre déclenche une émotion attestant de l’authenticité et la validité de la formulation. Qu’elle est la compétence du coach à identifier et actualiser les croyances qui peuvent s’opposer à la l’expression de la nouvelle identité ? Quelle sont les capacités du coach à établir une qualité de relation à la hauteur des changements attendus ? Les résultats recherchés dans certaines situations médicales peuvent amener le sujet en dehors de sa zone de confort pour s’aventurer dans des espaces non explorés de son inconscient. Dans ces espaces résident bien souvent les motivations et aspirations profondes au changement et aussi les anciennes blessures qui se sont cristallisées sous forme de croyances limitantes. Le coach a besoin de créer les conditions de confiance et de sécurité qu’exigent l’exploration de ces chemins peu fréquentés de notre inconscient.
3-La dynamique d’interaction. Hippocrate disait que la guérison nécessite un dialogue entre le médecin, le malade et la maladie, car celle-ci peut apporter une riche contribution au processus de guérison. Hippocrate devait être le père de l’intelligence collective dans le champ de la médecine. La résolution des problèmes complexes de santé nécessite de faire autre chose que ce qui a déjà été fait. Les solutions nouvelles les plus susceptibles de faciliter un processus de changement, ne viennent pas d’une des parties en présence mais du champ relationnel créé entre les parties en présence. L’espace de générativité créé par la richesse et l’authenticité des interactions entre patient, soignant/coach et la maladie constitue le terrain fertile à l’émergence de solutions qui n’ont jamais existé auparavant dans l’esprit des parties en présence. Nous pensons que bien rarement à donner la parole à la maladie, alors qu’elle est la première concernée par le processus. La maladie a pourtant une histoire à nous raconter, par exemple sur les circonstances émotionnelles de sa naissance, sur le message qu’elle tente de délivrer, et qui n’a jusqu’à présent pas pu être réellement écouté et pris en compte par une présence humaine.
La guérison résulte d’une forme d’intelligence collective, d’une mise en synergie de plusieurs expertises, celle des professionnels de santé qui disposent des technologies de pointe en matière de soin, celle du patient qui est le seul détenteur de sa source de vie, celle de la maladie qui détient les raisons cachées de sa présence, et celle d’un coach chef d’orchestre capable d’organiser avec les autres parties le champ relationnel susceptible de faire émerger les solutions les plus performantes pour faciliter le processus de guérison du patient, tout en donnant au soignants et coachs le sentiment de renouer avec le véritable sens de leur mission.
Dr Jean Luc Monsempès. Article initialement rédigé pour la revue Métaphore de NLPNL pour son congrès annuel de janvier 2019
Référence : How should we define health? BMJ (the British Medical Journal) 2011; 343:d4163